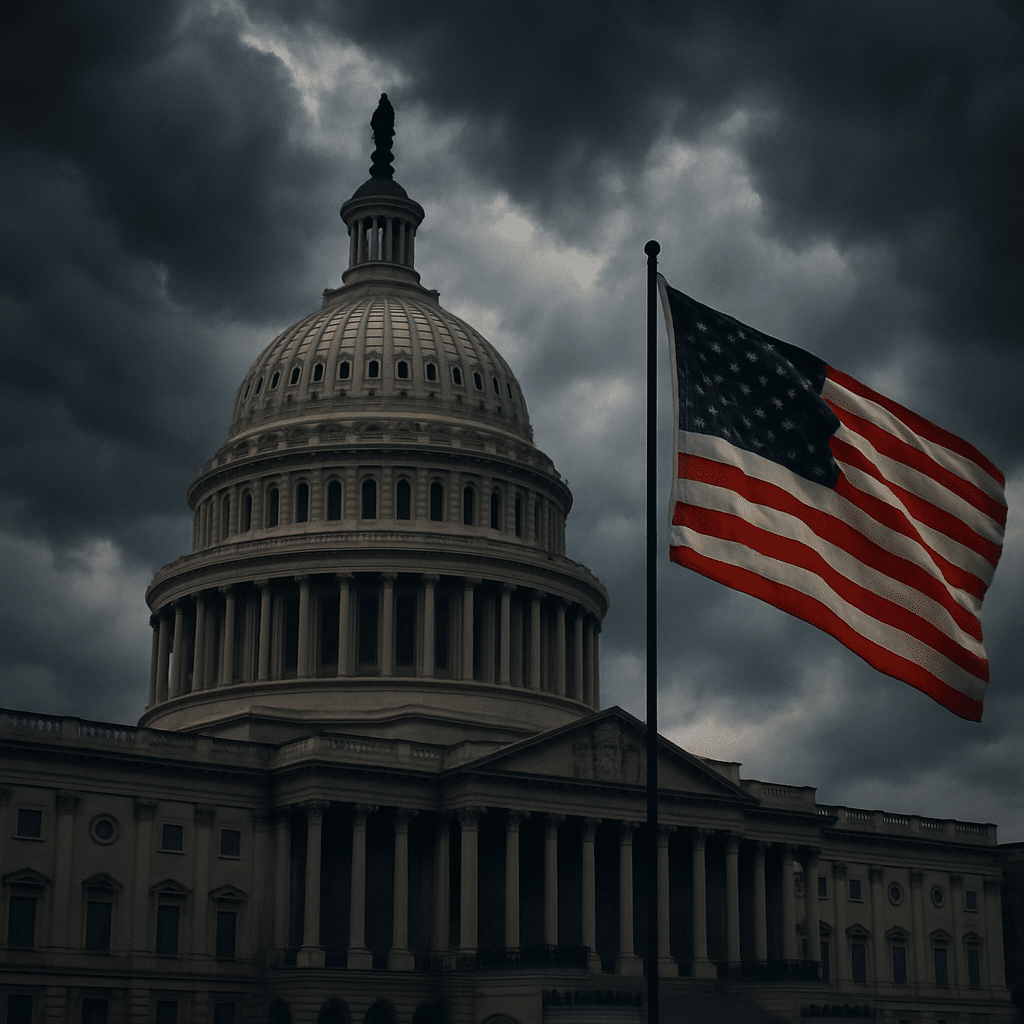La rentrée américaine s’annonce sous haute tension. Pour la première fois depuis cinq ans, la Réserve fédérale s’apprête à abaisser ses taux directeurs. Une décision qui reflète la fragilité persistante de l’économie américaine : marché de l’emploi hésitant, crainte de récession, tensions commerciales accrues… autant de signaux montrant que le grand cycle de croissance des États-Unis touche probablement à sa fin.
La stratégie de Trump : préserver une hégémonie en déclin
En renouant avec le protectionnisme, Donald Trump cherche à inverser une tendance lourde : le déclin relatif de la puissance américaine. Son objectif est clair : conserver l’hégémonie économique et politique des États-Unis dans un monde qui se détourne progressivement du dollar.
Pourtant, les chiffres inquiètent :
La dette publique a franchi les 37 000 milliards de dollars, soit près de 108 000 $ par habitant.
Le déficit budgétaire dépasse les 8 % du PIB, un niveau insoutenable dans un contexte de dédollarisation mondiale.
Le déficit commercial atteint 1 200 milliards de dollars : les États-Unis importent deux fois plus qu’ils n’exportent.
Les faillites d’entreprises ont bondi de 20 % en un an.
L’endettement des ménages atteint 17 500 milliards, avec des dettes record sur cartes de crédit (1 300 milliards) à des taux dépassant 20 %.
L’accès au logement s’éloigne : les taux hypothécaires dépassent 7 %, et l’âge médian des primo-accédants est désormais de 56 ans (contre 31 ans en 1981).
Résultat : le taux d’épargne des ménages est tombé à 3,5 %, un plancher comparable à celui de la crise de 2008.
Des marchés financiers au sommet… mais déconnectés du réel
Malgré ces fragilités, Wall Street bat record sur record. Le S&P 500 et le Nasdaq sont portés par les géants technologiques et les valeurs de croissance. La capitalisation boursière totale des entreprises américaines dépasse 45 000 milliards de dollars, soit près de 170 % du PIB national.
Les États-Unis restent la destination privilégiée de l’épargne mondiale, mais cette financiarisation extrême révèle aussi ses limites :
désindustrialisation progressive,
capitaux orientés vers la spéculation plutôt que vers l’économie productive,
dépendance accrue aux services et aux importations.
Aujourd’hui, la production de biens ne représente plus que 10 % du PIB, contre 20 % dans les années 1980.
Un pari industriel semé d’embûches
Trump promet de réindustrialiser l’Amérique. Mais l’ambition paraît irréaliste :
Les chaînes de valeur mondiales se sont déplacées vers l’Asie, où la main-d’œuvre reste bien moins chère.
Les secteurs stratégiques (semi-conducteurs, batteries, terres rares) sont largement contrôlés par la Chine et ses partenaires.
L’automatisation réduit les besoins en main-d’œuvre : l’emploi industriel est passé de 20 % du PIB en 1980 à moins de 8 % aujourd’hui.
Vouloir ramener les emplois d’usine d’antan relève plus du slogan que d’une réalité économique viable.
La Fed sous pression
La Réserve fédérale se retrouve au cœur de ce jeu de forces contradictoires. Trump pousse pour davantage de baisses de taux et menace même de remplacer son président. Mais cette stratégie comporte un risque majeur : relancer l’inflation, déjà difficile à ramener sous les 2 %.
Avec deux ou trois baisses de taux anticipées dans les prochains mois, les investisseurs s’inquiètent d’une nouvelle spirale inflationniste, aggravée par la hausse des tarifs douaniers.
Un monde qui bascule à l’Est
En toile de fond, l’influence américaine recule. Les banques centrales du monde entier détiennent désormais davantage d’or que de bons du Trésor américain. L’accumulation d’or se concentre surtout en Asie, où Inde, Chine et Russie renforcent leurs alliances économiques et politiques, comme lors du récent sommet de l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS).
C’est tout un basculement stratégique qui se dessine : l’Amérique, encore soutenue par son secteur financier, avance vers une forme d’illusion de stabilité, tandis que de nouvelles puissances redessinent l’équilibre mondial.
Leçons de l’histoire
Toutes les grandes puissances qui ont bâti leur suprématie sur la finance et la force militaire ont fini par décliner :
L’Italie au Moyen Âge,
Les Pays-Bas à la Renaissance,
L’Angleterre au XIXe siècle.
Les États-Unis semblent désormais engagés dans ce même cycle historique. Comme toujours, une fin d’hégémonie annonce l’émergence d’un nouvel ordre mondial.