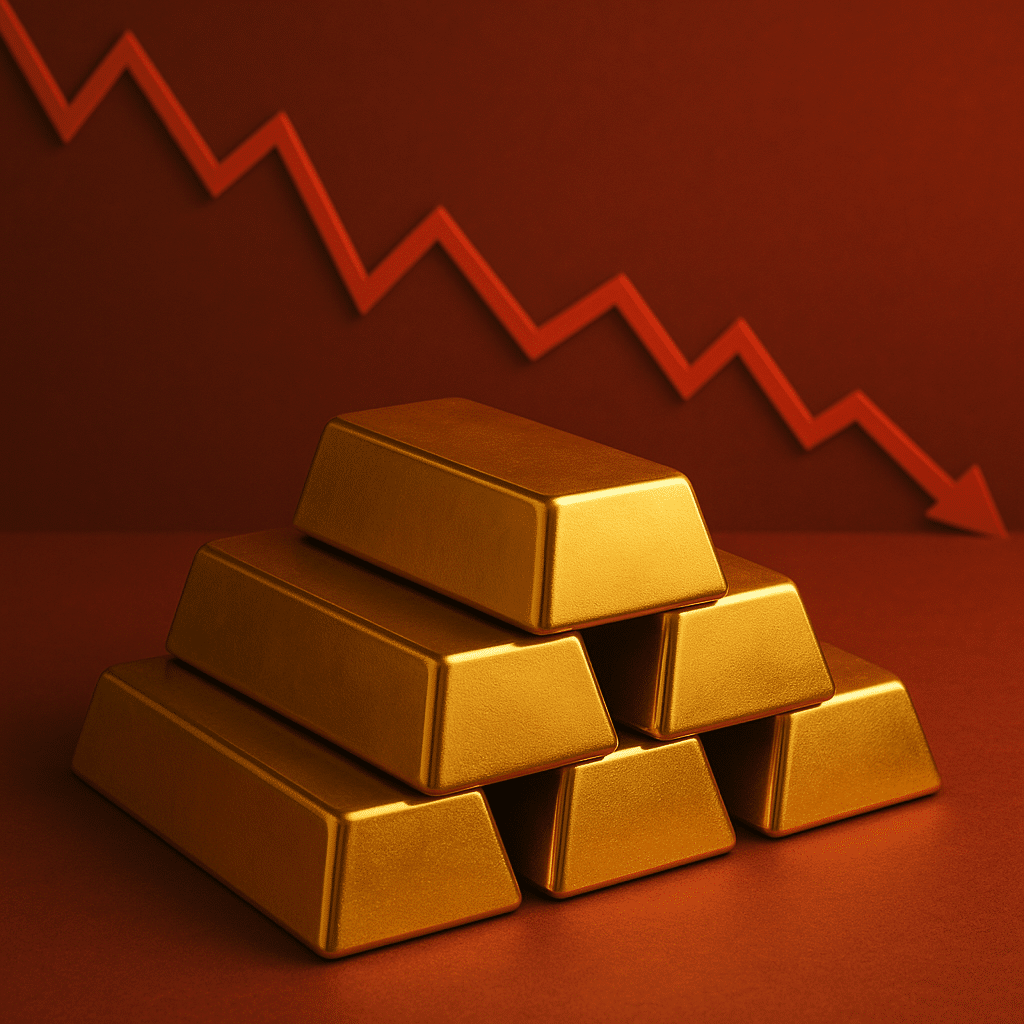L'histoire de l'or
L’or, métal le plus précieux depuis la nuit des temps
Depuis l’Antiquité il est utilisé en orfèvrerie pour créer des bijoux et des objets de luxe. L’or est le premier métal à être mentionné dans la Bible, il est aussi celui qui y est cité le plus de fois. Depuis toujours, l’or est un métal noble, précieux et rare. Il est un symbole de richesse.
Dans de nombreuses civilisations réparties à travers le monde, l’or est le symbole de dieu par excellence. En effet, l’or est un métal inaltérable au temps et donc associé à l’éternité. Sa couleur jaune éclatante qui reflète la puissance du soleil est associée à la lumière, à la puissance, au pouvoir.

Les Égyptiens de l’Antiquité considéraient l’or comme la chair des dieux. Les tombeaux des pharaons contenaient de très grandes quantités d’or. Le masque de Toutânkhamon à lui seul est composé de plus de 10 kg d’or.
Aujourd’hui, la plus importante statue d’or au monde qui mesure plus de 3 m pour une masse de 5,5 t est la statue du Bouddha d’or de Bangkok.
Dans la Bible, les hébreux associent l’or à la sainteté, à la pureté et à l’éclat spirituel. C’est pour cela qu’ils ont utilisé de très grandes quantités d’or dans le sanctuaire du Temple et le Tabernacle.
La rareté de l’or lui a conféré une valeur monétaire qui l’a rendu très utile dans les transactions commerciales.
Le Tabernacle construit par Moïse pour le culte de Dieu
Moïse reçu des instructions précises pour la construction du Tabernacle, la demeure de Dieu. On utilise de grandes quantités d’or. La quantité totale d’or employée pour les travaux du sanctuaire, produit des offrandes volontaires des Israélites, s’élevait à 943 kg
Le roi David avait rassemblé 490 tonnes d’or pour la construction du Temple de Jérusalem. Les Israélites, eux, ont donné 150 tonnes d’or comme offrande . Au moment de son intronisation, Salomon disposait déjà de 640 tonnes d’or ! (1 Chroniques 29 :3-8).
La construction du Temple de Jérusalem a duré 7 ans. Par ailleurs, environ 20 tonnes d’or arrivent chaque année chez Salomon. La reine de Saba elle-même, lors de son déplacement à Jérusalem, donne 3,5 tonnes d’or au roi.
Salomon fait fabriquer 200 grands boucliers et 300 boucliers en or battu. Le riche souverain fait enfin recouvrir son trône d’or et confectionner toute sa vaisselle en or pur (1 Rois 10 : 14-25).
Dans le livre de l’Apocalypse
On retrouve aussi de nombreux symboles en or dans le livre de l’Apocalypse (autel, chandeliers, couronnes, …). L’or est le matériau de choix pour le culte pur. Il exprime la sainteté, la pureté et l’éclat spirituel. Il témoigne de toute la valeur et la puissance de certains symboles, évènements et messages de Dieu.
Garantie des métaux précieux à travers l’Histoire (de 1260 à nos jours)
1260 : le statut des orfèvres
Étienne Boileau, prévôt de Paris sous Louis IX, rédige le livre des métiers qui réglemente les corporations d’arts et métiers. La charte parisienne des Orfèvres impose notamment à ces derniers diverses prescriptions afin de garantir le titre des ouvrages.
1275-1313 : les poinçons de titre
En 1275, Philippe III Le Hardi prescrit par une ordonnance royale, la marque des ouvrages en argent, au moyen d’un poinçon propre à chaque communauté d’orfèvres. En 1313, son successeur, Philippe IV le Bel, étend l’usage de la marque aux ouvrages d’or.
1355 : les poinçons de maître
Une ordonnance royale de Jean II Le Bon impose à tout orfèvre d’apposer sur les ouvrages de sa fabrication un poinçon spécial représentant une fleur de Lys couronnée, muni d’un symbole personnel.
1579-1674 : l’ébauche d’une réglementation fiscale de la garantie.
- 1579 : création sous Henri III d’une « taxe générale » sur les ouvrages d’or et d’argent bientôt appelée droit de remède.
- 1674 : la mise en place d’un « droit de marque et de contrôle » par Colbert s’accompagne d’un vaste mouvement de rationalisation des impôts avec l’instauration de la Ferme générale.
Une institution royale de la perception avec ses poinçons propres de charge et de décharge et ses règles particulières de marque s’est progressivement mise en place à côté de la réglementation corporative du titre (poinçons de jurande).
La période Révolutionnaire
La nuit du 4 août 1789
L’abolition des privilèges, parmi lesquels figuraient ceux des membres de la corporation des orfèvres, est proclamée.
1791 : La loi Le Chapelier
Le 2 mars 1791, la loi Le Chapelier pose le principe de la liberté du travail et réalise de façon plus concrète l’abolition des jurandes et des maîtrises en interdisant les associations professionnelles.
En avril 1791, les impôts indirects sont supprimés. À partir de cette période, il n’existe donc plus ni organisme exerçant un contrôle sur les titres de métaux précieux, ni impôts sur ces métaux. L’abondance des fraudes, le laxisme, et le manque à gagner pour l’État sont très rapidement ressentis.
La loi du 19 Brumaire An VI (9 novembre 1797)
À la suite d’une déclaration d’urgence du Conseil des Anciens, la loi « relative à la surveillance du titre et à la perception des droits de garantie des matières et ouvrages d’or et d’argent » est promulguée le 19 brumaire An VI (9 novembre 1797).
Elle concerne en effet les titres, les poinçons, les droits de garantie, les bureaux de la Garantie et leur personnel aussi bien que les diverses obligations des orfèvres pour la fabrication et la vente de leurs ouvrages, l’affinage des métaux et la répression des fraudes.
Les poinçons « officiels » vont remplacer les poinçons de jurande et de la marque (charge et décharge). Cette loi fixe les bases de la Garantie actuelle.
La période contemporaine
1926 : Les bureaux de garantie placés sous le contrôle des Monnaies et Médailles sont regroupés dans une direction nationale relevant de l’administration des contributions indirectes.
1949 : Des services spécialisés des contributions indirectes, créés en 1880 et chargés de la réglementation relative aux sucres et distilleries, sont rattachés à la direction de la garantie.
1993 : En 1993, les contributions indirectes entrent dans le champ de compétence de la direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI). La direction de la garantie et des services industriels (DGSI) devient la direction nationale de la garantie et des services industriels (DNGSI), partie intégrante de l’administration des douanes.
1994 : La loi du 4 janvier 1994 maintient la tradition des ouvrages à haut titre de 22 et 18 carats (916 et 750 millièmes) et ouvre le marché à une nouvelle gamme de produits contenant 585 et 375 millièmes d’or (14 et 9 carats).
Elle permet, en outre, à une entreprise privée (fabricant domicilié en France) d’être habilitée à apposer elle-même un poinçon de titre, à condition de respecter un cahier des charges précis.
2001 : 1er janvier, suppression de la direction de la garantie et des services industriels (DNGSI), ses missions sont intégrées dans les structures douanières.
29 août, création d’un nouveau titre légal à 999 millièmes pour chacun des métaux précieux.
20 novembre, fixation des seuils de dispense du poinçon de garantie, à un poids inférieur à 3 grammes pour les ouvrages en or et en platine et à 30 grammes pour les ouvrages en argent : les articles doivent cependant être aux titres aux légaux et marqués du poinçon de fabricant ou de responsabilité.
2002 : 3 janvier, précisions relatives à la commercialisation des ouvrages constitués de métal précieux et de métal commun juxtaposés : l’indication du prix de vente doit être accompagnée de la mention du nom des métaux entrant dans la composition de l’ouvrage. Cette information est portée sur les étiquettes et sur tout document commercial ou publicitaire faisant mention d’un prix de vente.
2003 : 31 décembre, modernisation de la garantie des métaux précieux :
- l’extension de la délégation de poinçon aux importateurs, acquéreurs intracommunautaires, commissaires-priseurs, responsables d’un crédit municipal ou d’une société de ventes volontaires de meubles enchères publiques et commissionnaires en garantie ;
- l’agrément de laboratoires accrédités et reconnus comme organismes de contrôle agréés (OCA) par la direction générale de la compétitivité, de l’industrie et des services et la direction générale des douanes et droits indirects.
2004 : 25 mars, suppression des formalités de visa de bordereaux et de factures pour les marchands ambulants, dispense des poinçons de garantie pour les ouvrages postérieurs à 1838 déjà revêtus d’anciens poinçons français de garantie.
30 juin, suppression du droit spécifique acquitté lors de la commercialisation des ouvrages.
1er juillet, mise en place d’une contribution payée par les opérateurs non bénéficiaires d’une délégation de poinçons en cas d’essai et de marquage de leurs ouvrages par les bureaux de garantie.
30 décembre, suppression de la distinction or et alliage d’or : les ouvrages d’or titrant 375 millièmes et 585 millièmes peuvent bénéficier de l’appellation «or» lors de leur commercialisation au stade du détail auprès des particuliers ;
– dispense du poinçon de garantie pour les ouvrages introduits sur le territoire national en provenance d’un autre État membre de l’Union européenne ou importés d’un autre État partie à l’accord instituant l’Espace économique européen ou de Turquie, sous certaines conditions mentionnées dans la documentation en ligne sur le site internet de la douane.
2006 : 21 juillet, dépôt de la déclaration de profession : il doit être accompagné d’une attestation d’enregistrement à la chambre des métiers ou au registre du commerce ou d’une copie de l’extrait K bis de la société mentionnant l’activité de fabrication, importation,vente ou achat d’ouvrages en métaux précieux, de doublage ou placage de l’or, de l’argent ou du platine.
2009 : 16 décembre, aménagements apportés à la tenue du livre de police : l’opérateur a notamment la possibilité de ne pas indiquer le poids et le titre des ouvrages neufs sur le registre papier et le registre informatisé, si l’identification des ouvrages est possible grâce au numéro de série ou à la référence commerciale de l’ouvrage indiqués dans un catalogue.